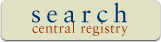News:
Affaire Wildenstein: Scandale en toile de fond
Paris Match 13 February 2011
Par Danièle Georget

En mai 1963, Georges Wildenstein, 71 ans, (le père de Daniel) reçevait "Paris Match" dans le bureau de son hôtel particulier rue de La Boétie, à Paris
Des querelles d’héritage révèlent la face sombre et même odieuse de la plus grande dynastie de marchands d’art.
La voiture s’est arrêtée devant le 57, rue La Boétie, l’adresse de l’institut Wildenstein, à Paris, et en est repartie le coffre plein. Ça s’est fait en plein jour, sans que personne ne crie aux voleurs. Un butin d’une trentaine d’œuvres. Des cambrioleurs ? Non, la police. L’OCBC, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui venait, dans un grand fracas de sirènes, de retrouver la « Chaumière en Normandie » de Berthe Morisot, une des toiles « disparues » de la succession Rouart. L’inventaire, après la mort d’Annie, avait été réalisé par Daniel Wildenstein, sur délégation de son fils Guy, désigné comme exécuteur testamentaire en même temps qu’Olivier Daulte, le fils de François Daulte, historien d’art. Vingt-quatre toiles ont déjà été retrouvées dans le coffre de ce dernier en Suisse. « Tout le monde peut se tromper », aimait dire Daniel Wildenstein. Il ajoutait que c’était même arrivé à la Reine d’Angleterre qui gardait, dans son grenier à Balmoral, des œuvres appartenant à l’Etat soviétique...
La Reine d’Angleterre a toujours été le modèle des Wildenstein. Sylvia, la seconde femme de Daniel, l’a découvert en devenant sa veuve. Princesse consort, elle a perdu son royaume, échangé contre une rente, puis son nom. C’est sous celui de Sylvia Roth, en bisbille avec ses beaux-fils, qu’elle a été enterrée cet hiver à Paris. Son avocate, Me Claude Dumont-Beghi, avait demandé l’inventaire de la fortune de Daniel, le défunt mari, au motif que, mariée sans contrat à New York, en 1978, et résidant en France, elle devait prétendre au régime de la communauté réduite aux acquêts. Sa pension annuelle de 400 000 euros et l’appartement de 600 mètres carrés sur le bois de Boulogne ne pouvant suffire à régler ses dettes. Sylvia s’est creusé la tête pour faire ressurgir sa liste des trésors disparus. « Avenue Montaigne, disait-elle, nous avions assez peu de tableaux, à cause des grandes fenêtres. Mais j’avais un Bonnard, superbe, que mon mari m’avait offert par amour : le “Nu rose à la baignoire”. A New York, où nous allions deux fois par an, c’était autre chose. Il y en avait dans toutes les pièces, jusque dans la salle de bains. Des Cézanne, des Renoir, ça changeait tout le temps... » Tout le capital serait placé dans des fonds hébergés dans des paradis fiscaux. Pour cette dynastie, la fortune relève de la substance gazeuse : elle s’évapore dès qu’on cherche à l’inscrire dans un bilan comptable.
Chez les Wildenstein, le goût du nomadisme remonte à l’arrivée des Prussiens en Alsace, en 1870. Nathan, à peine 20 ans, a l’amour de la France. Il vote avec ses pieds, comme on dit alors, et emporte pour toute fortune son « œil de maquignon », l’outil qui, depuis des générations, sert à distinguer un bon cheval d’une haridelle. Il n’a jamais pensé devenir marchand d’art. Il n’a peut-être jamais vu d’œuvre d’art. Affamé, il se fait embaucher chez un tailleur de Vitry-le-François, pour la seule raison, disait-il, que le nom de la ville lui avait inspiré confiance. Mais bientôt, il se propose pour négocier, à Paris, des toiles dont une cliente veut se débarrasser. Il commence par se renseigner au Louvre où il oublie aussitôt ses tweeds et ses cachemires. Comme Claudel à Notre-Dame ou Moïse sur le mont Sinaï, Nathan Wildenstein reçoit la grâce. Elle s’incarne dans l’art du XVIIIe siècle. Une mine d’or qui gît à ciel ouvert, pour cause de désaffection du public. Avec sa commission, 1 000 francs de l’époque, il élabore sa première théorie : « Qui va à Drouot tous les jours doit pouvoir gagner de quoi manger... et de quoi racheter. » De quoi oser, aussi : il demande la main de Laure, fille d’imprimeur. Une union bourgeoise qui vaut bien un mensonge : Nathan oublie ses ancêtres marchands de chevaux, se prétend orphelin et fils de rabbin... Un homme neuf qui refait sa vie dans l’ancien.
Trente-cinq ans après, en 1905, il a fait son chemin. Comme les Rothschild, il a son hôtel particulier dans le VIIIe, son château, Marienthal, à Verrières-le-Buisson, son écurie de course – casaque bleue, toque bleu clair –des maîtres d’hôtel, des cuisiniers... Mais c’est Laure qui continue à remplir les fiches après chaque visite chez les particuliers, clients ou amis. Son job, c’est de noter qui possède quoi et où. Puis elle emmène son petit-fils Daniel s’aérer à Auteuil. Elle le fait parier. Comme elle a pris soin de miser sur tous les concurrents, il est toujours gagnant. C’est comme ça qu’il prend goût aux courses. Un jour, il aura des centaines de chevaux et tant de haras qu’il lui arrivera de se tromper de propriété, sur les routes d’Irlande. Il aura surtout l’immense fierté d’avoir gagné cinq fois... et demie (pour cause de différend avec les juges de ligne) le Prix de l’Arc de Triomphe.
En ce temps-là, quand on téléphone rue La Boétie, on s’entend demander : « C’est pour les chevaux ou pour les tableaux ? » A table, on ne parle jamais peinture. Sur ce sujet, le père, Nathan, et le fils, Georges, sont d’humeurs divergentes : Nathan veut vendre, Georges accumule. Le père croit au passé, le fils mise sur l’avenir. « Picasso ? dit Nathan. Un garçon si exquis, si intelligent... Qui osera lui dire d’arrêter de peindre ? » Il ne veut travailler qu’avec « des morts. Les autres sont impossibles ! ». Mais Georges est l’ami de Monet, de Bonnard, puis des surréalistes. Pour ne pas voir toutes ces « horreurs » chez lui, Nathan lui achète un local, au 21 de la même rue où, en association avec Paul Rosenberg, il pourra exposer ses « nouveautés ». Nathan a tort de se faire autant de souci, et tort de ne pas s’en faire davantage : il ne voit pas arriver la crise de 1929. Il a envoyé Georges en Union soviétique, pour l’affaire du siècle. Staline échange les chefs-d’œuvre du musée de l’Ermitage contre des tracteurs. Associés au milliardaire américain Mellon, à l’Arménien Gulbenkian, les Wildenstein emportent des Watteau, Rembrandt, Rubens, Raphaël... qui perdent 80 % de leur valeur. Staline peut se moquer du capitalisme. La clientèle est ruinée. Le stock de 3 000 tableaux, dont 500 chefs-d’œuvre, s’effondre.
LA FAMILLE DÉMENT TOUTE COLLABORATION AVEC LES NAZIS MAIS DANIEL N’EXCLUAIT PAS DE POSSIBLES « ERREURS » DANS LES RESTITUTIONS
On brade. Et Georges, l’« intellectuel », prend patience en s’achetant un magazine, « Beaux Arts », et en classant ses « vieux papiers ». Il est en train d’inventer la pierre philosophale qui va transmuter la toile peinte en lingots d’or : le « catalogue raisonné » qui fait du commerçant un expert, et de la partie, un juge. On n’ira plus seulement chez les Wildenstein pour vendre ou acheter, mais pour savoir si l’on est propriétaire d’une croûte ou d’un trésor. Nathan avait ouvert une galerie à New York où prospéraient ses clients les plus riches. Georges en crée une à Londres, au 147 New Bond Street, dans l’ancienne demeure de l’amiral Nelson. L’idéal pour se lancer à la conquête d’un empire... En 1937, le stock est rétabli. Mais on danse sur un volcan. Daniel rejoint bientôt la ligne Maginot.
L’Histoire, toujours l’Histoire. Elle a poussé les Wildenstein hors d’Alsace, elle va les contraindre à quitter la France. Ils sont juifs et l’Amérique leur offre une assurance vie. Daniel emporte dans son paquetage une toile grande comme une boîte de cigares : le paysage à la vespasienne acheté à Seurat à 14 ans. Son premier fils, Alec, naît à Marseille, où l’on attend les paquebots, et le second, Guy, à New York, où ils arrivent.
Déchus de leur nationalité, ils ont confié la galerie à un employé... Mais elle est soumise au Commissariat général aux questions juives qui engloutit les bénéfices. Car, à Paris, les affaires continuent. Acheteurs en uniforme, vendeurs pressés... Hector Feliciano consacre seize lignes aux W, dans son imposant « Musée disparu » (Gallimard, 1995) : « Après l’Armistice, Georges exploite discrètement ses contacts au sein de la haute hiérarchie nazie pour conclure de nombreuses ventes en France pendant l’Occupation », écrit-il. L’accusation – assez vague – poussera le Congrès juif mondial à inscrire Georges sur une liste de suspects, et fera bondir son fils Daniel. La saisie par la police, à l’institut Wildenstein, de bronzes et de dessins appartenant à la collection Reinach, en partie spoliée par les nazis, la fait ressurgir.
Daniel Wildenstein a toujours démenti cette « collaboration », mais il a laissé entrevoir de possibles « erreurs » dans les restitutions d’après-guerre. En 1945, la marée qui arrive d’Allemagne dépose dans des hangars, où veillent les conservateurs de musées, le bric-à-brac fauché par les nazis. Pour récupérer son bien, il faut être là. Vivant, mais aussi muni de photos, de factures. Pour cela, on peut compter sur les Wildenstein. Entre ceux qui les accusent de les avoir volés et ceux qui les accusent de leur avoir refusé une entrée au « catalogue raisonné », ils accumulent les ennemis. Ils s’en font même de nouveaux...
Ainsi, André Malraux. Dans « Marchands d’art » (cosigné avec Yves Stavridès, édition Plon, 1999), Daniel raconte comment son père a accusé le ministre de la Culture de De Gaulle de n’avoir pas seulement volé des bas-reliefs à Angkor, mais d’en avoir fait « retailler », pour mieux les écouler. Il donne le nom du sculpteur à Marseille : Louis Dideron. Ainsi commence ce que les Wildenstein considèrent comme leur troisième guerre mondiale, celle qui sera à l’origine de leur installation aux Etats-Unis.
En 1963, l’élection de Georges à l’Académie des beaux-arts donne à Malraux l’occasion de se venger : il n’entérine pas le vote. Daniel affirme que son père en est mort. Alors, il baptise un de ses pur-sang « Goodbye Charlie » et déménage à New York où les œuvres sont rangées dans six niveaux de sous-sols. Daniel ne veut plus payer d’impôts en France où, soi-disant, il ne réside plus. Mais on sait qu’il ne peut pas se passer de Paris. Alors on suit ses traces à ses dépenses et on finit par lui confisquer son passeport ! C’est la guerre avec Giscard. Comme en 1940, la France manque d’aviation. Les fantassins du fisc regardent passer les jets privés. On dit que Daniel glisse des toiles sous ses sièges. C’est faux, répond-il. Il n’y a pas assez de place. En tout cas, pas pour les grands formats. A l’approche de 1981, pourtant, on fait entrer des civières dans la carlingue. La peur de la gauche au pouvoir, l’angoisse devant l’impôt sur le capital, les crises de rhumatisme... C’est fou le nombre de malades qui ont soudain besoin de se faire soigner en Suisse.
Jocelyn aussi trouvait les avions bien pratiques. Comment faire autrement pour transporter les huit chiens et le singe depuis le ranch de 30 000 hectares au Kenya ? Quand beau-papa lui a retiré l’usage du jet, elle a compris que son mariage avec Alec était terminé. Elle menace de parler des trusts qui dissimulent les propriétés... Puis elle se tait. Alec s’est remarié avec Lioubia, une jeune fille russe qui devient bientôt sa veuve. Elle aussi a la mémoire des trusts. Ceux qui aiguisent toujours l’appétit de Me Dumont-Beghi, que la mort de sa cliente Sylvia laisse – provisoirement – sur sa faim. L’affaire Wildenstein n’est pas terminée. Avec la saisie des 11 et 12 janvier, à l’institut, un nouvel acteur commence même à écrire sa partie : le juge André Dando. L’été dernier, il mettait en examen Karim Benzema et Franck Ribéry pour « sollicitation de prostituée mineure ». L’affaire Zahia commençait. Le juge Dando se méfie des amateurs de chefs-d’œuvre.
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Affaire-Wildenstein-Scandale-en-toile-de-fond-250829/
Par Danièle Georget

En mai 1963, Georges Wildenstein, 71 ans, (le père de Daniel) reçevait "Paris Match" dans le bureau de son hôtel particulier rue de La Boétie, à Paris
Des querelles d’héritage révèlent la face sombre et même odieuse de la plus grande dynastie de marchands d’art.
La voiture s’est arrêtée devant le 57, rue La Boétie, l’adresse de l’institut Wildenstein, à Paris, et en est repartie le coffre plein. Ça s’est fait en plein jour, sans que personne ne crie aux voleurs. Un butin d’une trentaine d’œuvres. Des cambrioleurs ? Non, la police. L’OCBC, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui venait, dans un grand fracas de sirènes, de retrouver la « Chaumière en Normandie » de Berthe Morisot, une des toiles « disparues » de la succession Rouart. L’inventaire, après la mort d’Annie, avait été réalisé par Daniel Wildenstein, sur délégation de son fils Guy, désigné comme exécuteur testamentaire en même temps qu’Olivier Daulte, le fils de François Daulte, historien d’art. Vingt-quatre toiles ont déjà été retrouvées dans le coffre de ce dernier en Suisse. « Tout le monde peut se tromper », aimait dire Daniel Wildenstein. Il ajoutait que c’était même arrivé à la Reine d’Angleterre qui gardait, dans son grenier à Balmoral, des œuvres appartenant à l’Etat soviétique...
La Reine d’Angleterre a toujours été le modèle des Wildenstein. Sylvia, la seconde femme de Daniel, l’a découvert en devenant sa veuve. Princesse consort, elle a perdu son royaume, échangé contre une rente, puis son nom. C’est sous celui de Sylvia Roth, en bisbille avec ses beaux-fils, qu’elle a été enterrée cet hiver à Paris. Son avocate, Me Claude Dumont-Beghi, avait demandé l’inventaire de la fortune de Daniel, le défunt mari, au motif que, mariée sans contrat à New York, en 1978, et résidant en France, elle devait prétendre au régime de la communauté réduite aux acquêts. Sa pension annuelle de 400 000 euros et l’appartement de 600 mètres carrés sur le bois de Boulogne ne pouvant suffire à régler ses dettes. Sylvia s’est creusé la tête pour faire ressurgir sa liste des trésors disparus. « Avenue Montaigne, disait-elle, nous avions assez peu de tableaux, à cause des grandes fenêtres. Mais j’avais un Bonnard, superbe, que mon mari m’avait offert par amour : le “Nu rose à la baignoire”. A New York, où nous allions deux fois par an, c’était autre chose. Il y en avait dans toutes les pièces, jusque dans la salle de bains. Des Cézanne, des Renoir, ça changeait tout le temps... » Tout le capital serait placé dans des fonds hébergés dans des paradis fiscaux. Pour cette dynastie, la fortune relève de la substance gazeuse : elle s’évapore dès qu’on cherche à l’inscrire dans un bilan comptable.
Chez les Wildenstein, le goût du nomadisme remonte à l’arrivée des Prussiens en Alsace, en 1870. Nathan, à peine 20 ans, a l’amour de la France. Il vote avec ses pieds, comme on dit alors, et emporte pour toute fortune son « œil de maquignon », l’outil qui, depuis des générations, sert à distinguer un bon cheval d’une haridelle. Il n’a jamais pensé devenir marchand d’art. Il n’a peut-être jamais vu d’œuvre d’art. Affamé, il se fait embaucher chez un tailleur de Vitry-le-François, pour la seule raison, disait-il, que le nom de la ville lui avait inspiré confiance. Mais bientôt, il se propose pour négocier, à Paris, des toiles dont une cliente veut se débarrasser. Il commence par se renseigner au Louvre où il oublie aussitôt ses tweeds et ses cachemires. Comme Claudel à Notre-Dame ou Moïse sur le mont Sinaï, Nathan Wildenstein reçoit la grâce. Elle s’incarne dans l’art du XVIIIe siècle. Une mine d’or qui gît à ciel ouvert, pour cause de désaffection du public. Avec sa commission, 1 000 francs de l’époque, il élabore sa première théorie : « Qui va à Drouot tous les jours doit pouvoir gagner de quoi manger... et de quoi racheter. » De quoi oser, aussi : il demande la main de Laure, fille d’imprimeur. Une union bourgeoise qui vaut bien un mensonge : Nathan oublie ses ancêtres marchands de chevaux, se prétend orphelin et fils de rabbin... Un homme neuf qui refait sa vie dans l’ancien.
Trente-cinq ans après, en 1905, il a fait son chemin. Comme les Rothschild, il a son hôtel particulier dans le VIIIe, son château, Marienthal, à Verrières-le-Buisson, son écurie de course – casaque bleue, toque bleu clair –des maîtres d’hôtel, des cuisiniers... Mais c’est Laure qui continue à remplir les fiches après chaque visite chez les particuliers, clients ou amis. Son job, c’est de noter qui possède quoi et où. Puis elle emmène son petit-fils Daniel s’aérer à Auteuil. Elle le fait parier. Comme elle a pris soin de miser sur tous les concurrents, il est toujours gagnant. C’est comme ça qu’il prend goût aux courses. Un jour, il aura des centaines de chevaux et tant de haras qu’il lui arrivera de se tromper de propriété, sur les routes d’Irlande. Il aura surtout l’immense fierté d’avoir gagné cinq fois... et demie (pour cause de différend avec les juges de ligne) le Prix de l’Arc de Triomphe.
En ce temps-là, quand on téléphone rue La Boétie, on s’entend demander : « C’est pour les chevaux ou pour les tableaux ? » A table, on ne parle jamais peinture. Sur ce sujet, le père, Nathan, et le fils, Georges, sont d’humeurs divergentes : Nathan veut vendre, Georges accumule. Le père croit au passé, le fils mise sur l’avenir. « Picasso ? dit Nathan. Un garçon si exquis, si intelligent... Qui osera lui dire d’arrêter de peindre ? » Il ne veut travailler qu’avec « des morts. Les autres sont impossibles ! ». Mais Georges est l’ami de Monet, de Bonnard, puis des surréalistes. Pour ne pas voir toutes ces « horreurs » chez lui, Nathan lui achète un local, au 21 de la même rue où, en association avec Paul Rosenberg, il pourra exposer ses « nouveautés ». Nathan a tort de se faire autant de souci, et tort de ne pas s’en faire davantage : il ne voit pas arriver la crise de 1929. Il a envoyé Georges en Union soviétique, pour l’affaire du siècle. Staline échange les chefs-d’œuvre du musée de l’Ermitage contre des tracteurs. Associés au milliardaire américain Mellon, à l’Arménien Gulbenkian, les Wildenstein emportent des Watteau, Rembrandt, Rubens, Raphaël... qui perdent 80 % de leur valeur. Staline peut se moquer du capitalisme. La clientèle est ruinée. Le stock de 3 000 tableaux, dont 500 chefs-d’œuvre, s’effondre.
LA FAMILLE DÉMENT TOUTE COLLABORATION AVEC LES NAZIS MAIS DANIEL N’EXCLUAIT PAS DE POSSIBLES « ERREURS » DANS LES RESTITUTIONS
On brade. Et Georges, l’« intellectuel », prend patience en s’achetant un magazine, « Beaux Arts », et en classant ses « vieux papiers ». Il est en train d’inventer la pierre philosophale qui va transmuter la toile peinte en lingots d’or : le « catalogue raisonné » qui fait du commerçant un expert, et de la partie, un juge. On n’ira plus seulement chez les Wildenstein pour vendre ou acheter, mais pour savoir si l’on est propriétaire d’une croûte ou d’un trésor. Nathan avait ouvert une galerie à New York où prospéraient ses clients les plus riches. Georges en crée une à Londres, au 147 New Bond Street, dans l’ancienne demeure de l’amiral Nelson. L’idéal pour se lancer à la conquête d’un empire... En 1937, le stock est rétabli. Mais on danse sur un volcan. Daniel rejoint bientôt la ligne Maginot.
L’Histoire, toujours l’Histoire. Elle a poussé les Wildenstein hors d’Alsace, elle va les contraindre à quitter la France. Ils sont juifs et l’Amérique leur offre une assurance vie. Daniel emporte dans son paquetage une toile grande comme une boîte de cigares : le paysage à la vespasienne acheté à Seurat à 14 ans. Son premier fils, Alec, naît à Marseille, où l’on attend les paquebots, et le second, Guy, à New York, où ils arrivent.
Déchus de leur nationalité, ils ont confié la galerie à un employé... Mais elle est soumise au Commissariat général aux questions juives qui engloutit les bénéfices. Car, à Paris, les affaires continuent. Acheteurs en uniforme, vendeurs pressés... Hector Feliciano consacre seize lignes aux W, dans son imposant « Musée disparu » (Gallimard, 1995) : « Après l’Armistice, Georges exploite discrètement ses contacts au sein de la haute hiérarchie nazie pour conclure de nombreuses ventes en France pendant l’Occupation », écrit-il. L’accusation – assez vague – poussera le Congrès juif mondial à inscrire Georges sur une liste de suspects, et fera bondir son fils Daniel. La saisie par la police, à l’institut Wildenstein, de bronzes et de dessins appartenant à la collection Reinach, en partie spoliée par les nazis, la fait ressurgir.
Daniel Wildenstein a toujours démenti cette « collaboration », mais il a laissé entrevoir de possibles « erreurs » dans les restitutions d’après-guerre. En 1945, la marée qui arrive d’Allemagne dépose dans des hangars, où veillent les conservateurs de musées, le bric-à-brac fauché par les nazis. Pour récupérer son bien, il faut être là. Vivant, mais aussi muni de photos, de factures. Pour cela, on peut compter sur les Wildenstein. Entre ceux qui les accusent de les avoir volés et ceux qui les accusent de leur avoir refusé une entrée au « catalogue raisonné », ils accumulent les ennemis. Ils s’en font même de nouveaux...
Ainsi, André Malraux. Dans « Marchands d’art » (cosigné avec Yves Stavridès, édition Plon, 1999), Daniel raconte comment son père a accusé le ministre de la Culture de De Gaulle de n’avoir pas seulement volé des bas-reliefs à Angkor, mais d’en avoir fait « retailler », pour mieux les écouler. Il donne le nom du sculpteur à Marseille : Louis Dideron. Ainsi commence ce que les Wildenstein considèrent comme leur troisième guerre mondiale, celle qui sera à l’origine de leur installation aux Etats-Unis.
En 1963, l’élection de Georges à l’Académie des beaux-arts donne à Malraux l’occasion de se venger : il n’entérine pas le vote. Daniel affirme que son père en est mort. Alors, il baptise un de ses pur-sang « Goodbye Charlie » et déménage à New York où les œuvres sont rangées dans six niveaux de sous-sols. Daniel ne veut plus payer d’impôts en France où, soi-disant, il ne réside plus. Mais on sait qu’il ne peut pas se passer de Paris. Alors on suit ses traces à ses dépenses et on finit par lui confisquer son passeport ! C’est la guerre avec Giscard. Comme en 1940, la France manque d’aviation. Les fantassins du fisc regardent passer les jets privés. On dit que Daniel glisse des toiles sous ses sièges. C’est faux, répond-il. Il n’y a pas assez de place. En tout cas, pas pour les grands formats. A l’approche de 1981, pourtant, on fait entrer des civières dans la carlingue. La peur de la gauche au pouvoir, l’angoisse devant l’impôt sur le capital, les crises de rhumatisme... C’est fou le nombre de malades qui ont soudain besoin de se faire soigner en Suisse.
Jocelyn aussi trouvait les avions bien pratiques. Comment faire autrement pour transporter les huit chiens et le singe depuis le ranch de 30 000 hectares au Kenya ? Quand beau-papa lui a retiré l’usage du jet, elle a compris que son mariage avec Alec était terminé. Elle menace de parler des trusts qui dissimulent les propriétés... Puis elle se tait. Alec s’est remarié avec Lioubia, une jeune fille russe qui devient bientôt sa veuve. Elle aussi a la mémoire des trusts. Ceux qui aiguisent toujours l’appétit de Me Dumont-Beghi, que la mort de sa cliente Sylvia laisse – provisoirement – sur sa faim. L’affaire Wildenstein n’est pas terminée. Avec la saisie des 11 et 12 janvier, à l’institut, un nouvel acteur commence même à écrire sa partie : le juge André Dando. L’été dernier, il mettait en examen Karim Benzema et Franck Ribéry pour « sollicitation de prostituée mineure ». L’affaire Zahia commençait. Le juge Dando se méfie des amateurs de chefs-d’œuvre.
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Societe/Actu/Affaire-Wildenstein-Scandale-en-toile-de-fond-250829/
© website copyright Central Registry 2024